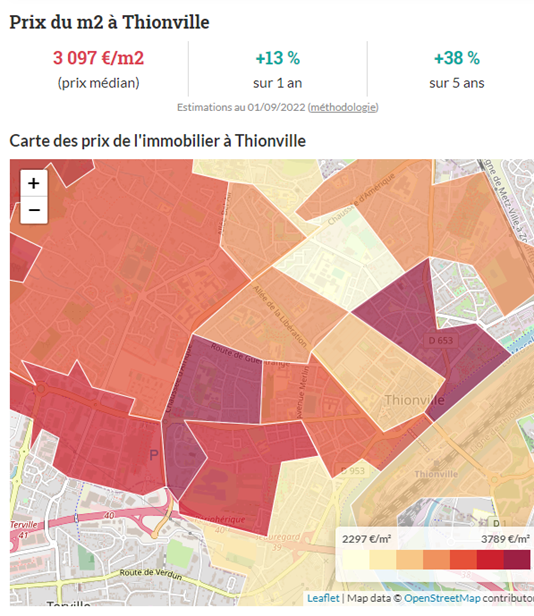L’arrivée de catégories pauvres dans une région très riche engendre de nombreux problèmes socio-économiques, dont la ghettoïsation. L’embourgeoisement dans la baie de San Francisco est marqué par un phénomène de suburbisation et de forte ségrégation sociale. La présence de millionnaires et multimillionnaires dans la Silicon Valley crée un entre-soi d’ultras riches.
Le revenu annuel moyen par famille et par personne dans quelques municipalités (communities)
Source : Laurent Carroué, « La Silicon Valley, un territoire productif au cœur de l’innovation mondiale et un levier de la puissance étatsunienne », Géoconfluences, mai 2019.
Les ultras riches se regroupent principalement dans les villes de Altos Hills et de Palo Alto à proximité de Stanford. Ces deux villes ont un revenu médian très élevé. L’achat d’une propriété, évaluée à plus de 3 millions de dollars, devient inaccessible même si le revenu par habitant est 60 % supérieur à la moyenne californienne. Le salaire moyen des 1 % les plus riches a augmenté de 219 % depuis le début des années 2000 grâce au boom de la haute technologie. Dans le même temps, le salaire moyen des 99 % restants s’est accru de 34 %.
La baie de San Francisco est le territoire le plus riche des États-Unis, avec 47 millionnaires pour 1000 habitants en 2010 (Lemhan-Frisch et Leriche). Parmi eux, un quart tire leur fortune des hautes technologies (Lemhan-Frisch). Les ultras riches se concentrent principalement dans la Silicon Valley, car c’est le berceau de l’économie de la connaissance et du numérique. Les sièges sociaux de nombreuses entreprises multinationales y sont situés, ce qui en fait un lieu de pouvoir indéniable. La Silicon Valley a pour ambition d’attirer les talents les plus qualifiés au monde dans la logique du brain drain. Les ingénieurs sont recrutés à l’échelle internationale, souvent à plus de 30 % du prix du marché du travail.
Les ultra-riches se réunissent dans un club très sélectif, un des plus élitistes du pays, le Menlo Circus Club à Altherton. Le ticket d’entrée s’élève à 250 000$. L’adhésion coûte 60 000$ et l’abonnement mensuel est de 500$. Être membre du club offre beaucoup d’avantages, il permet d’entrer dans un réseau très influent où figurent des personnalités célèbres au monde.
La concentration des plus riches dans un entre-soi ne produit pas les effets classiques d’éviction de populations pré-établies. L’embourgeoisement se matérialise par une impossibilité de se loger pour les travailleurs, entraînant alors des pratiques de contournements pour les worker homeless (travailleurs sans domicile) et les workampers (travailleurs campeurs). Face aux coûts de la vie trop importants dans la baie de San Francisco, il y a de plus en plus d’habitants utilisant des pratiques de contournement. Les Workampers sont de plus en plus nombreux, ils utilisent des caravanes ou des camping-cars pour se loger qu’ils achètent à un prix variant entre 5 000 et 20 000 $. Il y a plusieurs avantages à cet habitat, comme sa mobilité ou son coût rapidement amorti. Il s’est développé sur la plupart des routes menant de San Francisco à la Silicon Valley. Cependant, cet habitat demeure précaire, soumis aux conditions météorologiques, à l’insécurité ou au manque d’hygiène.
Sans abris dans la Silicon Valley.
Source : NBC News, 15 septembre 2021.
D’autre part, on peut évoquer la condition des worker homeless appelés aussi « nomades », qui vivent dans leur voiture. Le reportage de l’Effet Papillon montre les conditions de vie dégradées d’une professeure de l’université de San José, Ellen James Penney, qui vit dans sa voiture avec son mari. Cette paupérisation est accentuée par l’absence d’accès à l’eau courante et au manque d’hygiène. Les worker homeless mettent alors en place des stratégies de contournement afin de ne pas être stigmatisé comme un sans-abri.
« La Silicon Valley peut-elle trouver sa boussole morale dans la lutte contre les sans-abri ? »
Source : Gabrielle Lurie, The Guardian, 3 novembre 2018.
L’embourgeoisement dans la baie de San Francisco est ainsi un condensé de l’explosion des inégalités socio-économiques à l’œuvre aux Etats-Unis aujourd’hui.
Article et étude de cas réalisés par Marine Berthelet.
Bibliographie:
Carroué Laurent, « La Silicon Valley, un territoire productif au cœur de l’innovation mondiale et un levier de la puissance étatsunienne », Géoconfluences, mai 2019.
Ghorra-Gobin Cynthia. « De l’alliance de la ville et de la haute technologie : les enseignements de la Silicon Valley ». L’Espace géographique, tome 21, n°2, 1992. p.109–118.
Lehman-Frisch Sonia. « « Gentrifieurs, gentrifiés » : cohabiter dans le quartier de la Mission (San Francisco) », Espaces et sociétés, vol. 132–133, no. 1-2, 2008, p. 143–160.
Lehman-Frisch Sonia, et Frédéric Leriche. « La Silicon Valley. Symbole du capitalisme industriel américain ? » La Géographie, vol. 1580, no. 1, 2021, p. 24–29.
Lehman-Frisch Sonia et Authier Jean-Yves. « Exposer ses enfants à la mixité. Discours et pratiques des parents de classes moyennes-supérieures dans deux quartiers gentrifiés de Paris et San Francisco ». Politiques sociales et familiales, n° 117, 2014. Dossier « La résidence alternée ». p. 59–70.
Lehman-Frisch, Sonia. « San Francisco, ville injuste ? La capitale du progressisme états-unien à l’épreuve de la croissance des inégalités », Annales de géographie, vol. 714, no. 2, 2017, p. 145–168.
Leriche Frédéric, « Les paradoxes de la puissance californienne », Géoconfluences, juillet 2015.
Magda Maaoui, « East Palo Alto : un suburban ghetto au cœur de la Silicon Valley (Californie) », Urbanités, mis en ligne le 13 mai 2015.
Walker, R.P. et Schafran, « L’étrange cas de la région de la baie ». Environnement et planification, 2015
Vidéographie :
L’Effet Papillon, 13 juin 2018, États-Unis : sur la route, YouTube, 20.36 min.